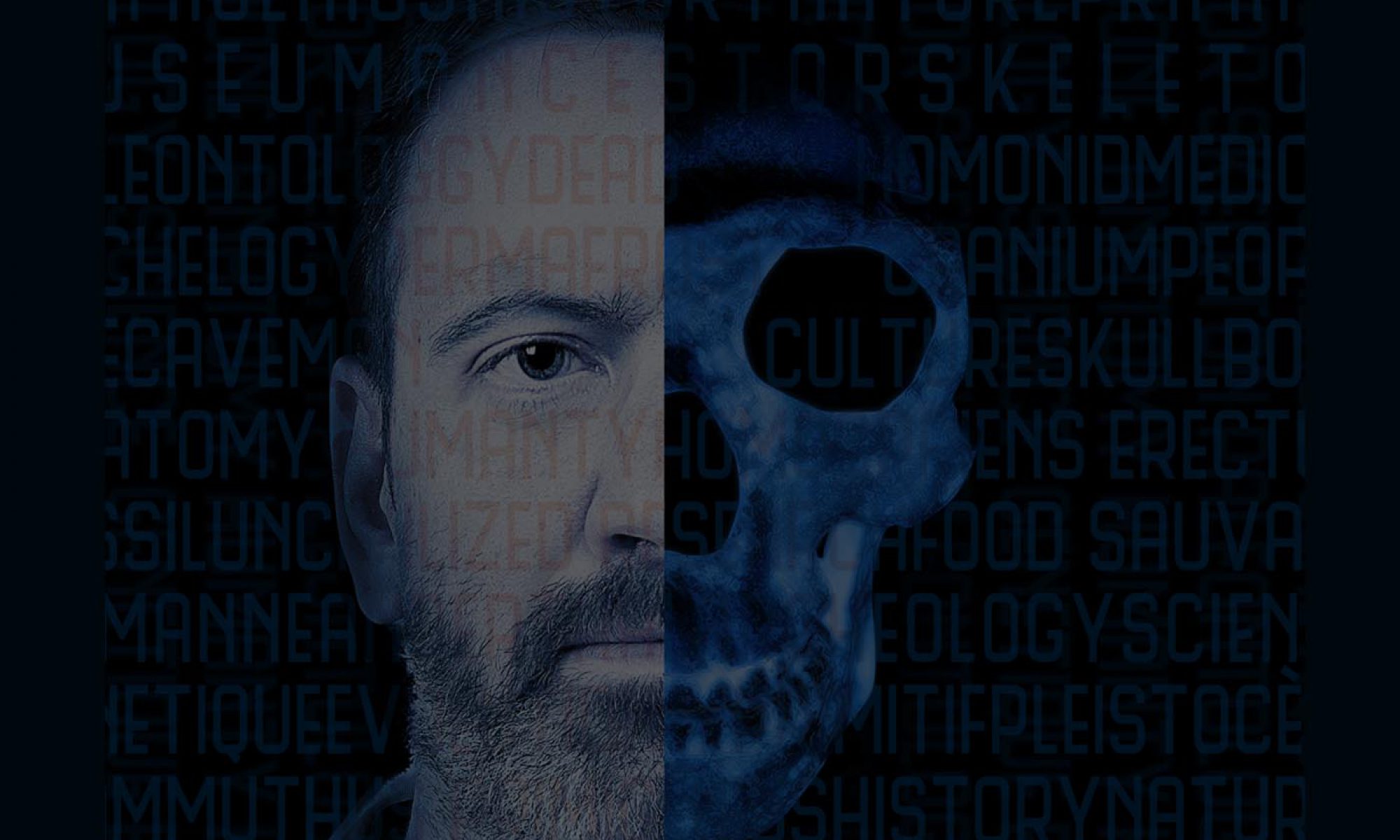Le Labourd
Du haut de son promontoire, Sylvia observait l’étrange délégation sur le sentier bordant l’Uroneko Erreka, le ruisseau qui passait à proximité de son village. Enfouie dans les hautes herbes brulées par le soleil de l’été qui se terminait, nul ne pouvait deviner sa présence. Depuis toute petite, elle avait appris à se dissimuler telle une ombre. Les gens du village ne les appréciaient guère, elle et sa mère, Rita, bien qu’ils fassent appel à ses services lorsque la maladie les frappait. Les villageois d’Ahetze se méfiaient de cette guérisseuse et de sa vagabonde de fille, n’hésitant pas à les traiter de sorcières et à leur attribuer les causes d’un malheur ou d’une mauvaise récolte.
Toutes les deux s’en moquaient éperdument et Sylvia prenait même un malin plaisir à entretenir cette croyance ridicule. Consciente que sa seule beauté, aussi pure qu’innocente, dévoyait déjà les hommes si faibles d’esprit. Aussi, elle aimait se revêtir de l’odeur des fleurs qu’elle récoltait lors de ses longues ballades dans la lande avoisinante et qui finissaient en onguents qu’elle préparait sous la supervision de sa mère. Une pratique que réprouvait le curé village, condamnant l’utilisation du parfum, jugeant cette pratique comme le symbole de mœurs trop légères et de traditions païennes. quel mal y avait-il à sentir bon?
La carriole en contrebas s’arrêta et des hommes vêtus de noir en descendirent aussitôt. L’escorte, composée d’une dizaine de soldats, mirent pied à terre. Alors que certains satisfaisaient un besoin naturel, d’autres accompagnèrent les chevaux au bord du ruisseau afin qu’ils se désaltèrent. Plus que l’accoutrement burlesque des dignitaires en noir, qui coiffés de hauts chapeaux pointus de la même couleur que leurs habits s’étaient réunie pour tenir un conciliabule, c’étaient les soldats lui faisant face, leurs attributs à l’air afin de se soulager, qui l’amusa. Certes, l’anatomie masculine ne lui était pas totalement étrangère pour avoir vu des croquis dans le précieux grimoire de sa maternelle, mais c’était la première fois qu’elle en observait de si près. Malgré la dizaine de mètres les séparant, elle distinguait parfaitement ces petits tuyaux atrophiés dont sortait un jet discontinu de liquide jaunâtre. Dire que la vie provient du même organe qui servait à évacuer les déchets du corps humain, pensa-t-elle avec dégout.
Sans un bruit, elle rampa à reculons afin de se mettre hors de vue. Ce n’est qu’une fois à l’orée du petit bois qui se trouvait sur l’autre versant de la colline qu’elle se débarrassa des mauvaises herbes qui s’étaient accrochées à sa robe de serge écru qu’elle avait enfilé par dessus son jupon. Elle en profita pour réajuster les lanières de son bustier d’un blanc grisâtre, qui enfermait sa poitrine naissante. Ceci fait, elle empoigna son sac de toile qui contenait le petit couvre-chef en tissu dont elle se coiffa pour maintenir son épaisse chevelure noire bouclée. Avant de placer sa musette en bandoulière, elle contempla son butin du jour. Essentiellement du Milleperthuis, une plante dont se servait sa mère pour guérir les brulures, mais qui avait aussi la réputation d’éloigner les esprits néfastes. En traversant le ruisseau, elle avait eu la chance de dénicher une pierre de foudre. Les paysans accrochaient au-dessus du seuil de leur porte ces cailloux d’aspects singuliers, que la croyance populaire attribuait à une chute du ciel, lors d’un orage. Tels des précieux talismans aux formes allongées, ils étaient censés protéger les habitations de la colère divine. Pour Sylvia, cela signifiait quelques sous en plus, de quoi agrémenter un peu l’ordinaire. Forts de leurs convictions religieuses, les puissants dédaignaient les légumes en estimant que des végétaux touchant le sol étaient indignes de leurs conditions. Sylvia et sa mère s’accommodaient aisément des bulbes et des racines cultivés sur un petit lopin de terre à l’arrière de leur bicoque. À ce régime s’ajoutaient les œufs des quelques poules en leur possession. Parfois un lapin sauvage se laissait prendre à l’un de ses collets qu’elle posait uniquement en cas de nécessité durant l’hiver, une saison plus difficile pour se sustenter en l’absence de ce que Dame Nature pouvait offrir le reste de l’année. Une entreprise toujours périlleuse car les seigneurs féodaux ne plaisantaient pas avec les braconniers. Il y a deux saisons, suite à une plainte du Baron d’Agramont, l’assemblée du Biltzar* n’avait pas hésité à condamner un imprudent à l’échaffaud sur la place publique de Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce pauvre malheureux avait eu l’outrecuidance de chasser des canards sauvages, un gibier, qui en tutoyant le royaume des cieux, ne pouvait que garnir la table des nobles du Labourd*.
Le sentier traversant le petit bois débouchait sur une zone plus marécageuse, parsemé de joncs et de roseaux. En cette fin d’été, le niveau de l’eau stagnante se trouvait au plus bas, mais il fallait rester prudent et prendre garde où poser les pieds sous peine de se retrouver embourbé jusqu’à la taille. Un danger qui ne préoccupait pas Sylvia, tant elle connaissait les pièges de ce marais comme sa poche. Sa maison se situait un peu à l’écart du village, ce qui lui convenait très bien. Elle entra par la porte de derrière et trouva sa mère plongée dans son grimoire. Ces dons de guérisseuse s’appuyaient sur les connaissances compilées dans ce livre si précieux, transmis à chaque génération. Un jour, le plus tard possible, elle en deviendrait l’heureuse propriétaire et perpétuerait ainsi la tradition familiale.
— Ah te voici ! s’exclama Rita d’un ton réprobateur.
Sylvia se contenta de sourire, devinant l’anxiété de sa mère quand elle disparaissait durant de longues heures. À bien des égards, Rita lui ressemblait autant par son caractère impétueux que par son physique qui restait plutôt avantageux par rapport aux femmes de son âge. Il faut dire que son corps avait été préservé de grossesses à répétition.
Sylvia n’avait jamais connu son père et Rita avait toujours éludé ses questions génantes, bien que légitimes, lorsqu’elle abordait le sujet. Cependant, certaines rumeurs lui étaient parvenues aux oreilles, comme quoi elle serait la fille d’un marin disparu en mer. D’autres racontaient qu’elle était le fruit d’une liaison avec un gentilhomme du coin. Tout comme elle, dans sa jeunesse la beauté de Rita avait nourri les jalousies de son voisinage.
— Tu m’as ramené ce que je t’ai demandé ?
— Oui, j’ai même trouvé une pierre de foudre, ajouta-t-elle en exhibant la pierre de forme ovoïde.
Sa mère s’en saisit pour l’examiner plus en détail.
— C’est une belle pierre! Justement le père Arluzea m’en a réclamé une, hier au marché, se réjouit-elle. Fais chauffer de l’eau, nous allons la laisser macérer dans une décoction de sureau. L’odeur suffira à rassurer le père Arluzea quant à ses propriétés magiques à éloigner le mauvais œil.
— Je doute que cela soit efficace, gloussa Sylvia.
— Ne sous-estime le pouvoir de l’esprit, ironisa sa mère. Parfois, il suffit de croire fort en quelque chose pour que cela se produise.
Sylvia éclata de rire à l’unisson de sa mère.
— Peu importe que ce soit efficace, l’essentiel sera les quelques pièces que ta trouvaille va nous rapporter, affirma-t-elle avec satisfaction.
Tout en joie, Sylvia se saisit du chaudron qu’elle suspendit à la crémaillère au-dessus du foyer éteint. Après l’avoir à moitié rempli d’eau, elle s’affaira à enflammer les brindilles à l’aide de son briquet à pierre. Une petite flammèche apparut et elle se dépêcha de l’attiser avec des sarments de vigne, avant d’y déposer une buche. Alors qu’elle regardait le bois s’embraser, la vision de l’étrange cortège lui revint en mémoire.
— Au fait, mère, j’ai aperçu des soldats qui convoyaient un carrosse aux portes de notre ville, déclara-t-elle.
— Le Baron d’Agramont ? demanda Rita sans lever les yeux.
— Je l’ignore, je n’ai vu aucunes armoiries, seulement les…
Sylvia ne termina pas sa phrase. Sa mère absorbée par sa tâche, celle de trier le Milleperthuis ramené par sa fille afin de le faire sécher au plus vite, ne vit pas les joues de sa fille s’embraser.
À suivre…
*Biltzar (ou Bilçar): est une assemblée représentative du Labourd (Pays basque français) qui a perduré jusqu’en 1789.
* Le Labourd (Lapurdi en basque, Labord en occitan) est un ancien fief féodal. Le territoire disparut lors de la révolution française avec la création du département des Pyrénées-Atlantiques. Selon l’Académie de la langue basque, le Labourd est un des sept territoires basques traditionnels.